Histoire du fonds ancien
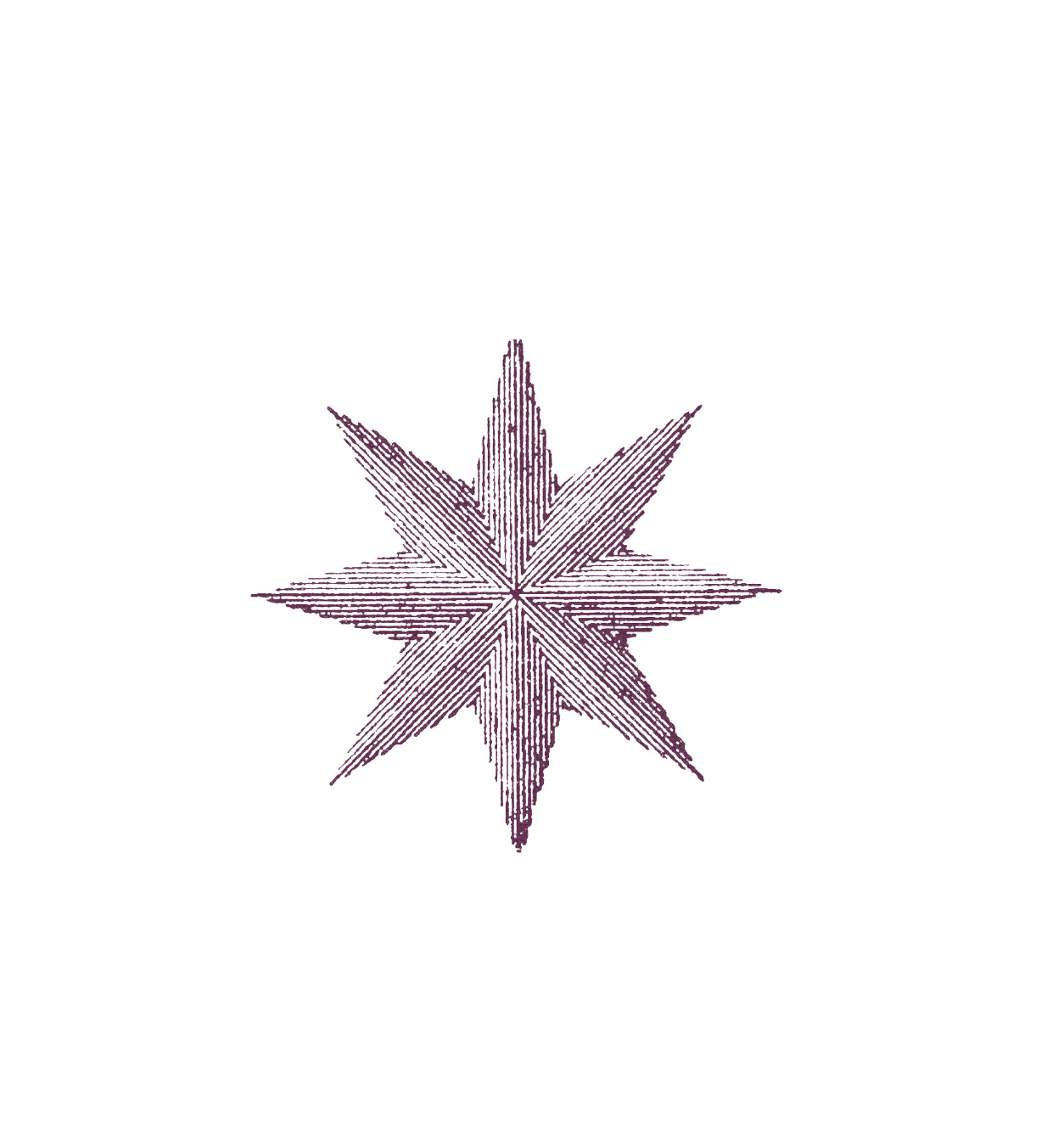
Les origines de la bibliothèque
Conçue en 1761, la Bibliothèque d’Yverdon-les-Bains est la plus ancienne bibliothèque publique de Suisse romande. C’est grâce à la Société économique de la Ville qu’elle a vu le jour.
1761 : la Société économique d’Yverdon
Première institution de lecture publique de Suisse romande, les origines de la bibliothèque d’Yverdon remontent à 1761, année de la création de la Société économique d’Yverdon. En mars de cette année, Elie Bertrand propose à plusieurs notables de la Ville d’Yverdon de créer une Société économique, filiale de celle de Berne. Dix-sept de ces notables répondent favorablement à cette invitation et fondent le 1er juin 1761 la Société économique d’Yverdon. Le bailli Victor de Gingins en est le président, Louis-Emmanuel Bourgeois le directeur et Jean-Georges Pillichody le vice-directeur. Le but de la société est «d’encourager les arts utiles» et «étendre le commerce», ainsi qu’on peut le lire dans le registre des procès-verbaux de l’époque.
Une collection scientifique
Le jour même, les membres décident «de rechercher les moyens de trouver des fonds pour se procurer les livres d’agriculture, d’arts et de commerce nécessaires, et même pour former avec le tems une Bibliotheque publique à l’usage de la Ville» (Registre, 1, p. 5). C’est donc une bibliothèque de travail avec une collection scientifique à caractère encyclopédique qui sera créée grâce aux dons des membres en argent, en livres et même en curiosités naturelles. Ces dons d’objets composent les débuts de la collection du Musée d’Yverdon qui ne se séparera de la bibliothèque qu’en 1904. Réservée dans un premier temps à une élite, la bibliothèque s’est ensuite ouverte à un public de plus en plus large.
Création de la Bibliothèque publique
En 1763, le Projet pour une Bibliothèque publique est approuvé par la société et le Conseil de la Ville donne 25 louis d’or, soit 400 francs, pour la création d’une Bibliothèque publique.
Une bibliothèque nomade
Au cours de ses nombreuses années d’existence, la bibliothèque a été localisée à divers endroits de la ville : le Château, le 2e étage de l’Hôtel de Ville, le collège secondaire, les combles du nouveau Casino (actuel Théâtre Benno Besson), l’ancien poste de police (actuelle Maison d’Ailleurs) et, depuis 1986, l’Ancienne-Poste.
Des documents précieux
Quatre registres conservent les procès-verbaux des séances de la Société économique ainsi que sa correspondance. Le Livre Blanc recense les donateurs et leurs dons. Ces documents précieux permettent de retracer l’histoire de la Bibliothèque.

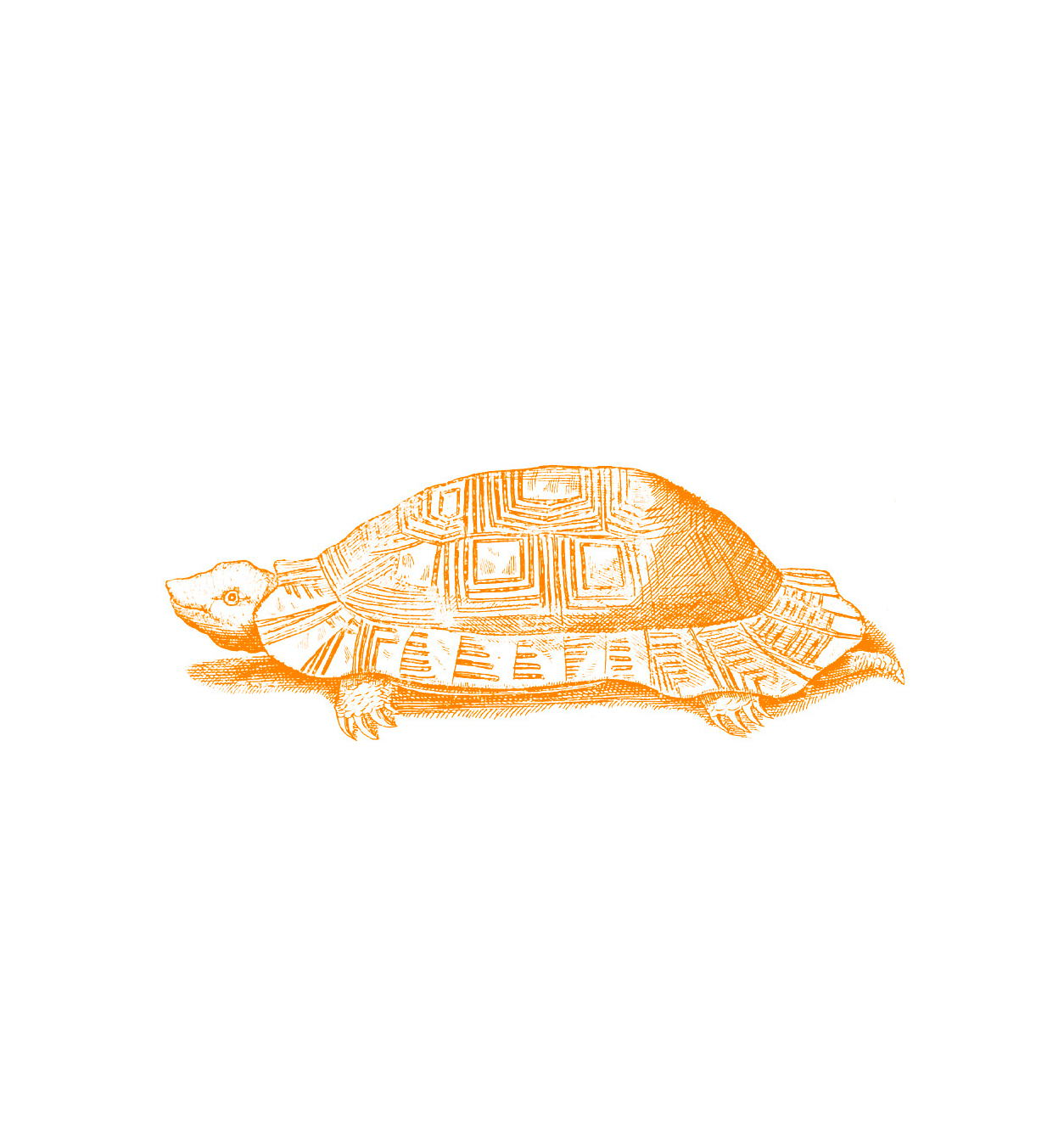
La conservation de la collection
Si la collection précieuse de la bibliothèque bénéficie aujourd’hui de bonnes conditions de conservation, cela n’a pas été le cas par le passé. Les nombreux déménagements et lieux de stockage inadaptés ont provoqué de graves dommages à ces ouvrages précieux qui ont nécessité et nécessitent encore d’onéreuses restaurations.
Des conditions strictement contrôlées
Depuis 1986, la Bibliothèque d’Yverdon-les-Bains est installée à la Place du 7 Février 4 (anciennement Place de l’Ancienne-Poste). Dans ce bâtiment, la collection précieuse bénéficie d’un local de conservation avec des conditions strictement contrôlées : une température d’environ 18° et une humidité relative entre 40 et 60%.
Avant d’être localisée dans le bâtiment de l’Ancienne-Poste, la bibliothèque a été située dans divers bâtiments de la ville. L’humidité et les variations de température de ces locaux ont endommagé les livres. De plus, la manipulation des ouvrages a conduit à une usure naturelle qui fragilise certains d’entre eux. L’intervention de restaurateurs professionnels est primordiale afin de garantir une meilleure conservation à ces documents rares et précieux.
Le travail des restaurateurs respecte plusieurs règles détaillées ci-après.
Un traitement aussi limité que possible
Le but est de diminuer la perte d’information.
Un traitement compatible avec toutes les matières composant l’objet
Les interactions chimiques des produits utilisés pour la restauration avec les matériaux du livre doivent être prises en compte. Pour cette raison, les restaurateurs ont recours à beaucoup de matériaux naturels comme des colles à base d’amidon ou de gélatine. Certains ouvrages de la bibliothèque d’Yverdon-les-Bains ont été traités avec de la colle de vessie d’esturgeon.
Un traitement réversible
L’intervention du restaurateur doit pouvoir être démontée en laissant le moins de traces possible.
Un traitement n’empêchant pas de futures recherches sur l’objet
Le but de la restauration est de diminuer la vitesse de vieillissement de l’objet afin de permettre sa consultation future dans les meilleures conditions possibles. Elle ne vise pas à rendre au livre un aspect neuf.
Le travail de restauration
La restauration d’un livre peut demander des dizaines d’heures de travail, selon le traitement qu’il nécessite. Cela peut aller d’un nettoyage des pages à une désacidification du papier ou un remplacement complet de la reliure.
Le restaurateur rédige un rapport détaillé du travail effectué sur le livre où chaque intervention est méticuleusement notée. On y retrouve l’état de conservation initial du livre ainsi que les méthodes et matériaux utilisés. Le restaurateur peut également joindre des photographies du livre avant et après restauration.
En 2010, le restaurateur Martin Strebel et l’historien Michel Schlup ont effectué un sondage des dégâts sur les livres de la collection précieuse de la bibliothèque d’Yverdon-les-Bains afin de définir des priorités pour les prochaines restaurations. Le résultat de ce travail, qui prend en compte l’état de chaque livre et son intérêt historique, démontre l’importance de poursuivre le travail de restauration dans les années à venir.




